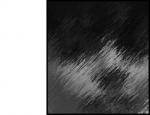Vers un parti socialiste révolutionnaire
Duncan Hallas (1971)
L’auteur était un marxiste anglais, membre de la direction du Socialist Workers Party (G-B). Il est mort en octobre 2002. Né dans une famille ouvrière à Manchester en 1925, tour à tour apprenti, conscrit pendant la deuxième guerre mondiale (il a participé à une mutinerie des troupes britanniques en Egypte quelques mois après la fin de la guerre), ouvrier qualifié, enseignant, puis permanent du SWP jusqu’en 1995, Duncan Hallas a contribué à former plusieurs générations de socialistes révolutionnaires en Grande-Bretagne, ainsi qu’aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud. Il a écrit ce texte en 1971, à une époque où les International Socialists (l’ancêtre du SWP) commençaient à passer, pour la première fois depuis deux décennies, du stade d’un petit groupe de propagande à celui d’un (toujours petit) parti ouvrier révolutionnaire.
Dans ce texte Hallas confronte la tradition marxiste révolutionnaire sur la nature et le rôle du parti avec deux autres traditions contre lesquelles il fournit des arguments solides et réalistes : celle des « libertaires » pour lesquels toute organisation disciplinée dotée d’une direction ne peut conduire qu’à la dictature d’une bureaucratie, et celle des adeptes d’un parti d’ « avant-garde » sectaire et stérile.
Les événements des quarante dernières années [c’est-à-dire, depuis le début des années trente, NDLR] ont isolé la tradition socialiste révolutionnaire de la classe ouvrière dans les pays occidentaux. Notre première tâche doit être de la réintégrer. Les nombreuses luttes partielles et locales sur les salaires, les conditions de travail, le logement, les loyers, l’éducation, la santé etc. doivent être coordonnées et unifiées dans un mouvement cohérent fondé sur une stratégie pour avancer vers une véritable transformation de la société.
En termes de militants, une couche organisée de plusieurs milliers de travailleurs manuels et intellectuels, enracinée dans la masse des travailleurs et possédant une conscience collective de la nécessité de construire le socialisme et de la façon de l’atteindre, est nécessaire. Cette couche doit être créée - ou plutôt recréée. Elle existait dans les années vingt en Grande-Bretagne et ailleurs. Sa désintégration, au début sous l’influence du stalinisme et ensuite par l’interaction complexe du stalinisme, du fascisme et du « néo-réformisme », a complètement marginalisé la tradition authentiquement socialiste dans les pays capitalistes avancés. Au fur et mesure que cette tradition sort de son isolement, de vieux débats reprennent vie. De nouveau, on rediscute de la nature de l’organisation socialiste.
L’idée qu’une organisation de militants socialistes est nécessaire est un lieu commun à gauche, mis à part quelques anarchistes puristes. Mais de quel type d’organisation a-t-on besoin ? Un point de vue, très répandu parmi les étudiants et jeunes travailleurs radicalisés, est celui des libertaires. Presque par définition, ce terme recouvre plusieurs tendances distinctes. L’essence de ce qu’elles ont en commun est une hostilité à toute activité centralisée, coordonnée, et une profonde méfiance de tout ce qui relève de la « direction ». Selon ce point de vue, une fédération « lâche » de groupes de travail est tout ce qui est nécessaire et souhaitable. Ce qui est sous-entendu par cette idée est que les organisations centralisées subissent nécessairement une dégénération bureaucratique et que les actions spontanées des travailleurs sont la seule, et suffisante, base pour la réalisation du socialisme.
Les preuves du prétendu caractère inévitable de la dégénération des organisations ouvrières sont, au moins en apparence, accablantes. Les partis sociaux-démocrates classiques du début du 20ème siècle en sont un cas d’école. Ce fut la social-démocratie allemande qui fournit à Robert Michels la matière à partir de laquelle il formula sa théorie de « la loi de fer de l’oligarchie ». Les partis communistes, fondés initialement pour arracher les travailleurs ayant une conscience politique de l’influence des bureaucraties social-démocrates conservatrices, devinrent à leur tour bureaucratisés et autoritaires à un degré jamais imaginé pour des partis ouvriers. De plus, les organisations de masse de base, les syndicats, sont devenues partout un symbole de la bureaucratisation et ceci, apparemment, quelque soient les idées politiques de leurs dirigeants.
C’est de ce type de « preuve » que certains libertaires tirent la conclusion qu’un parti socialiste révolutionnaire est une contradiction en soi. Ceci est, bien sûr, la position traditionnelle anarcho-syndicaliste. Plus communément, il est admis qu’un parti pourrait, dans des circonstances favorables, éviter de tomber dans les bras de la classe dirigeante. Cependant, un tel parti, bureaucratisé par définition, contiendrait inévitablement en lui l’embryon d’un nouveau groupe dirigeant et, s’il réussissait, créerait une nouvelle société basée sur l’exploitation. L’expérience des partis staliniens au pouvoir est naturellement citée comme preuve de la vérité de cet argument.
La plausibilité de ce genre d’arguments vient en grande partie de leur nature très abstraite et donc universelle. Ce serait injuste de les mettre sur le même pied que les idées « bio-déterministes » actuellement en vogue, même si psychologiquement ils présentent une certaine similitude. Des auteurs comme [Desmond] Morris et [Robert] Ardrey évitent la tâche ardue et compliquée d’analyser les sociétés et les conflits réels en déduisant l’ « inévitabilité » de tel ou tel phénomène d’une prétendue « nature humaine » (voire « animale »). De la même façon, une grande partie de la pensée libertaire procède d’idées générales sur les méfaits de l’organisation formelle pour arriver à des conclusions extrêmement précises sans beaucoup d’efforts pour comprendre le cours réel des événements. Ainsi le stalinisme est interprété comme la conséquence « inévitable » de la prédilection de Lénine pour un parti centralisé. Quelques notions très générales, quelques supposées « vérités universelles » qu’on peut maîtriser facilement en une demi-heure remplacent une méthode théorique sérieuse. Comme le monde réel est très compliqué c’est très rassurant d’avoir à sa disposition les ingrédients d’une sagesse sociale instantanée. Malheureusement, c’est également très trompeur.
Mettre un signe d’égalité entre « organisation centralisée », « bureaucratie » et « dégénérescence » est une version laïque du mythe du péché originel. Comme son prototype, cette idée mène à des conclusions profondément réactionnaires. Car ce qu’on sous-entend est que la masse des travailleurs est incapable de contrôler démocratiquement ses propres organisations. Si l’on doit admettre que c’est ce qui s’est souvent produit, prétendre que ceci est nécessairement, et inévitablement le cas revient à prétendre que le socialisme est impossible parce que la démocratie, au sens littéral du terme, est impossible.
C’est précisément la conclusion à laquelle sont arrivés les théoriciens « néo-machiavéliens » de la société au début du vingtième siècle. Elle a pénétré profondément la sociologie moderne universitaire. Elle se trouve à la racine de ce qui passe pour la théorie sociale-démocrate moderne. Naturellement, les socialistes libertaires n’acceptent pas ces critiques. L’essence de leur position est le rejet du vieux cliché usé que la division entre les élites et les masses, les dirigeants et les dirigés, existera toujours. Néanmoins leur approche des questions d’organisation implique la conclusion opposée, pour la raison très simple que l’existence d’organisations formelles est une caractéristique essentielle de toute société complexe.
En réalité, une discussion fructueuse des problèmes liés à l’organisation socialiste est impossible au niveau des généralités « universelles ». Les organisations n’existent pas dans le vide. Elle sont composées de personnes réelles qui agissent dans des situations historiques précises, et qui essaient de résoudre des problèmes concrets en choisissant entre un nombre limité d’options. Ne pas tenir compte de ces considérations assez évidentes rend impossible tout débat. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les débats sur les origines du stalinisme.
Que le bolchevisme a engendré le stalinisme est un article de foi chez la majorité des libertaires. Ce point de vue est partagé par la grande majorité des auteurs sociaux-démocrates, libéraux-progressistes et conservateurs. Bien sûr, dans le sens purement formel que la bureaucratie stalinienne trouva ses origines au sein du parti bolchevique, cette idée est une évidence. Mais on ne va pas très loin avec cela. La même logique nous conduirait à conclure que Jésus Christ fut le père de l’Inquisition et Abraham Lincoln le père de l’impérialisme américain, mais personne, du moins on l’espère, n’imagine qu’on puisse tirer des conclusions utiles à partir de telles notions. La question est de savoir comment et pourquoi le stalinisme est apparu et quel rôle la structure du parti bolchevique a pu, éventuellement, joué dans ce processus.
La façon dont Daniel Cohn-Bendit traite de cette question sans son livre de 1968, « Le gauchisme», est intéressante à cet égard. Il entend démontrer que les Bolcheviks, loin de pousser la révolution russe vers l’avant, restreignaient les masses populaires entre février et octobre 1917, et plus tard, transformèrent la révolution en « contre-révolution bureaucratique », à cause de la nature, de la structure et de l’idéologie mêmes du parti dans les deux cas.
Le premier point sera traité plus tard. Le deuxième est développé au moyen de citations, choisi soigneusement pour démontrer la malveillance calculée de Lénine et de Trotsky. On explique, correctement, qu’en 1917 Lénine était pour l’autogestion des entreprises par des comités élus de travailleurs mais qu’en 1918 il a déclaré fermement qu’il était pour la gestion par un seul homme, que Trotsky en 1920 demanda la militarisation du travail et que la suppression de la révolte de Kronstadt en 1921 fut un tournant important dans le processus de perte du pouvoir pour les travailleurs russes. Ce qui est vraiment étonnant dans l’interprétation de Cohn-Bendit de ces événements est l’absence complète de toute considération des circonstances dans lesquelles ils eurent lieu. Les ravages de de la guerre et de la guerre civile, la ruine de l’industrie russe, la désintégration même de la classe ouvrière russe – tout ceci, apparemment, n’a aucune incidence sur le résultat final. Il admet en passant que la Russie était un pays arrièré et qu’elle était isolée par l’échec de la revolution allemande, mais, selon lui, ces facteurs généraux ne peuvent en aucune façon expliquer le tournant spécifique pris par la révolution.
On suppose généralement qu’il existe un lien entre le mode et le niveau de production des biens vitaux et les types d’organisation sociale qui sont possibles à une période donnée. Si ce n’était pas le cas la race humaine aurait pu passer sans doute directement, en un seul saut, de l’âge de pierre à une société socialiste.
Si on admet qu’une des conditions pour la réalisation du socialisme est un haut niveau d’industrialisation et une grande productivité du travail, alors quelques uns des « facteurs généraux », que Cohn-Bendit refuse allègrement de prendre en compte, prennent une importance certaine. La Russie au moment de la révolution n’était pas simplement un pays sous-développé. Rar rapport aux pays capitalistes développés de l’époque elle était très arrièrée. 80 % de la population dépendaient toujours de l’agriculture, contre 4,5 % en Grande-Bretagne.
L’économiste Colin Clark a estimé le revenu par personne active en Russie en 1913 à 306 unités, contre 1 071 unités pour la Grande-Bretagne. Selon les calculs de Clark, le chiffre de la Grande-Bretagne était déjà 370 unités en 1688, donc à un niveau beaucoup plus élevé que celui de la Russie en 1913. Il faut considérer ces calculs avec beaucoup de précaution, mais il apparaît clairement que les chances d’une transition immédiate à une société non-coercitive en Russie au début du 20ème siècle étaient très faibles. Il est vrai que l’homme ne vit pas que du pain ; le patrimoine culturel est important aussi. Le patrimoine culturel de la Russie était la barbarie tsariste. Il n’est pas surprenant qu’aucune tendance marxiste dans la Russie pré-révolutionnaire ne croyait que le socialisme était à l’ordre du jour dans une Russie isolée (même si cette illusion, il est vrai, avait été entretenue par les Narodniks).
Cependant, le niveau économique de 1913, aussi misérable fut-il, représentait la prospérite comparée à ce qui allait suivre. La guerre, la révolution, la guerre civile et l’intervention étrangère détruisirent l’appareil productif. En mai 1919 l’industrie russe ne recevait que 10 % de son alimentation normale en carburants. (1) A la fin de la même année, 79 % des voies ferrées avaient été mis hors usage – ceci dans un pays immense où les transports routiers n’existaient pratiquement pas. A la fin de 1920, la production totale de biens manufacturés était tombée à 12,9 % du niveau de 1913.
Les effets sur la classe ouvrière furent désastreux. En décembre 1918 il y avait deux fois moins d’ouvriers à Petrograd qu’en 1916. En décembre 1920, la ville avait perdu 57,5 % de sa population et Moscou 44,5 %. En 1917 il y avait plus de 3 millions de travailleurs industriels. En 1921 il n’en restait que 1,25 millions. La classe ouvrière russe fuyait vers la campagne pour éviter de mourir de faim. Mais quelle campagne ! Dans les zones rurales en 1920 – 21 la réalité, c’était la guerre, la famine, le typhus, les réquisitions par les Rouges et les Blancs, la disparition d’articles manufacturés jusqu’aux alumettes, au fuel domestique et au fil de coton. Selon Trotsky, des rapports arrivants de la province indiquaient même l’apparition du cannibalisme.
Dans ces conditions désespérantes, le parti bolchevique a dû substituer son propre pouvoir à celui d’une classe ouvrière décimée et épuisée qui ne représentait qu’une petite fraction de la population, et à l’intérieur du parti l’appareil grandissant se substituait aux militants de base. Tout ceci est indéniable, mais il semble raisonnable de penser que la situation réelle avait plus d’influence sur ces développements que « la nature, structure et idéologie mêmes » du parti. En réalité, le régime interne du parti était étonnamment ouvert à cette époque.
Le jugement le plus équilibré sur cette question est celui de Victor Serge, un communiste libertaire, témoin et acteur des événements : « on dit souvent que ‘le germe de tout le stalinisme’ était présent dès le début dans le bolchevisme’. Bien, je n’ai pas d’objection. Seulement, le bolchevisme contenait aussi une multitude d’autres germes – une énorme quantité d’autres germes – et ceux qui vécurent l’enthousiasme des premières années de la révolution victorieuse ne devraient pas l’oublier. Juger l’homme vivant d’après les germes que l’autopsie révèle dans son cadre – et qu’il peut très bien avoir porté depuis sa naissance – tout cela est-il très raisonnable ? »
Etant donné l’état arrièré de la Russie, la question de savoir quels germes allaient prospérer et quels germes allaient s’atrophier, lequel des dénouements possibles allait effectivement se réaliser, dépendait avant toute autre chose de la situation internationale.
La prise du pouvoir par les Bolcheviks eut lieu dans le contexte d’une révolution européenne. Les mouvements révolutionnaires étaient assez puissants pour renverser le kaiser allemand, l’empereur autrichien et le sultan turc, en plus du tsar russe. Ils étaient assez puissants pour empêcher les puissances étrangères de renverser le régime soviétique. Mais ils avaient avorté ou étaient écrasés avant d’atteindre le stade critique – l’établissement du pouvoir des travailleurs dans un ou deux pays avancés. Le fait que la révolution allemande en 1918-19 n’ait pas réussi à dépasser le stade d’une république capitaliste-démocratique semble avoir été décisif. La défaite des Spartakistes scella le sort du pouvoir ouvrier en Russie, car seule une aide économique substantielle d’une économie avancée – en réalité, d’une Allemagne socialiste – aurait pu inverser le processus de désintégration de la classe ouvrière russe.
La transformation de ce que Lénine, en 1921, appela « un Etat ouvrier et paysan déformé bureaucratiquement » en un capitalisme d’Etat totalitaire, fut le résultat d’un processus long et complexe. Ce qui importe ici est qu’une partie essentielle de ce processus fut la destruction de toutes les fractions et tendances du parti bolchevique. Pour que la contre-révolution réussisse il ne suffisait pas de liquider les diverses oppositions de gauche et de droite. Le parti était si peu adapté comme instrument « pour transformer la révolution en contre-révolution bureaucratique » qu’il fallait éliminer la majeure partie des cadres staliniens originels avant que la nouvelle classe dirigeante ne consolide sa position.
En 1934, l’année du 17ème Congrès du Parti, toute opposition ouverte dans le parti avait été supprimée depuis longtemps. Le sort des délégués à ce Congrès, qui étaient presque tous des staliniens, fut révélé par Khrouchtev en 1956. « Des 1 966 délégués, 1 108 furent arrêtés … Des 139 membres et candidats du comité central du parti élus à ce Congrès, 98, c’est-à-dire 70 %, furent arrêtés et fusillés. » En résumé, la très grande majorité de ceux qui avaient quelques racines dans le passé du parti bolchevique – 80 % des délégués au 17ème Congrès étaient membres du parti en 1921 – fut liquidée et remplacée par un nouveau personnel non-« contaminé » par des liens, même les plus faibles, avec le mouvement ouvrier.
Ces événements, qui ont eu des conséquences si profondes et si durables, sont des faits d’un ordre de grandeur tout-à-fait différent des défaillances, réelles ou imaginaires, des pratiques organisationnelles des Bolcheviks. Supposer autrement, c’est tomber dans ce volontarisme extrême que beaucoup de libertaires partagent avec les tenants du maoisme.
Il ne s’en suit pas que le modèle bolchevique en matière d’organisation doit être suivi en toutes circonstances. Savoir si la position de Lénine en 1903 est la bonne ou la mauvaise dans les conditions très différentes du capitalisme de la fin du 20ème siècle est tout simplement une question dépassée. L’ « avant-gardisme » de certaines sectes maoistes et trotskistes est le revers de la médaille libertaire. Les deux positions sont fondées sur une vision hautement abstraite et trompeuse de la réalité.
Ce qui est discutable ici est l’utilité de l’analogie de l’ « avant-garde ». Il est évident que tout parti socialiste révolutionnaire est nécessairement, dans un sens, une « avant-garde ». Mais cet argument n’est pas du tout, comme on le prétend, élitiste. L’essence de l’élitisme est l’affirmation que les différences observées en termes de capacités, conscience et expérience sont les conséquences de conditions génétiques ou sociales immuables et que les gens sont, aujourd’hui ou dans l’avenir, incapables d’exercer eux-mêmes le pouvoir. Rejeter cette position élitiste implique que ces différences ont, entièrement ou en partie, des causes qui peuvent être changées. Cela ne signifie pas nier les différences elles-mêmes.
La vraie objection à l’insistance sur la notion de « parti d’avant-garde » est que celle-ci fait souvent partie d’une vision obsolète du monde qui empêche de regarder les problèmes d’aujourd’hui en face et mène, dans des cas extrêmes, à une « fausse conscience » systématique – à une idéologie au sens marxiste stricte du terme.
Parler d’une « avant-garde » implique qu’il existe aussi un corps principal qui marche dans à peu près la même direction et qui partage au moins dans une certaine mesure une vision commune et des aspirations communes.
Quand, par exemple, Trotsky décrivait le Parti communiste allemand des années 1920 et du début des années 1930 comme l' « avant-garde » de la classe ouvrière allemande, cette description était juste. Non seulement le Parti lui-même incluait, parmi ses 250 000 membres, les plus éclairés, les plus énergiques et les plus confiants des travailleurs allemands, mais il opérait dans une classe ouvrière qui, dans son immense majorité, avait absorbé quelques uns des éléments de base de la pensée marxiste et qui fut confrontée, surtout à partir de 1929, à une crise sociale de plus en plus profonde qui ne pouvait pas être résolue dans le cadre de la république de Weimar.
Dans cette situation, les actions du parti étaient d’une importance décisive. Ce qu’il fit, ou ne fit pas, influenca tout le cours ultérieur de l’histoire européenne et du monde. Des polémiques dures sur les détails de la tactique, de l’histoire et de la théorie, qui étaient l’essentiel de la production des groupes communistes oppositionnels de l’époque, furent entièrement justifiées et nécessaires. Dans les circonstances données, l’avant-garde jouait un rôle décisif. Pour reprendre la métaphore frappante de Trotsky, un changement de ligne politique était comme aiguiller un train – il pouvait changer la direction de tout le mouvement ouvrier allemand.
Aujourd’hui les circonstances sont très différentes. Le train n’existe pas. Une nouvelle génération de travailleurs énergiques et compétents existe mais elle ne fait plus partie d’un mouvement cohérent et ne travaille plus dans un milieu ou les idées de base du marxisme sont répandues. Nous sommes revenus au point de départ. Non seulement l’avant-garde, dans le sens véritable d’une couche considérable de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires organisés, a été détruite, mais l’environnement, la tradition, qui lui donnaient une influence ont été détruits eux aussi. En Grande-Bretagne cette tradition n’a jamais été aussi répandue et puissante qu’en Allemagne ou en France, mais elle existait bel et bien dans la première période du Parti communiste.
Le problème essentiel est comment accélérer le processus déjà commencé de recomposition de cette tradition. Il est peut-être vrai, comme disait Gramsci, qu’il est plus difficile de créer des généraux que de créer une armée. Il est certainement vrai que des généraux sans une armée sont complètement inutiles, même si l’on suppose qu’on peut les créer dans le vide. En fait, l’ « avant-gardisme », dans ses formes les plus extrêmes, est une perversion idéaliste du marxisme, qui mène à une vision moraliste de la lutte de classe. Les travailleurs sont vus comme tirant à la laisse, toujours prêts et enthousiastes pour le combat mais continuellement trahis par des dirigeants corrompus et réactionnaires. Selon cette vision des choses, les dirigeants « de gauche » dont les paroles radicales cachent une détermination permanente à trahir à la première occasion sont particulièrement pernicieux.
Que de telles choses se passent réellement ne fait pas de doute. La corruption au sens strict du terme n’est pas inconnue dans le mouvement ouvrier britannique et dans certaines de ses manifestations plus subtiles elle est même répandue. Mais c’est un point de vue très simpliste que de supposer, par exemple, que l’histoire de la Grande-Bretagne depuis la deuxième guerre mondiale ne peut s’expliquer qu’en termes de « trahisons » et c’est complètement idiot d’imaginer que tout ce qu’il faut faire est de « construire une nouvelle direction » autour d’une secte ou une autre, puis de l’offrir comme alternative aux travailleurs qui n’attendraient que cela.
La réalité est plus complexe. Les éléments d’une direction ouvrière existent déjà. Les militants qui maintiennent les organisations de base du mouvement ouvrier par leur activité quotidienne constituent de fait la direction. Qu’ils soient en général plus ou moins sous l’influence des idées réformistes ou staliniennes ou des idées encore plus réactionnaires ne s’explique pas en termes de trahison, mais résulte de leur propre expérience et de l’absence d’une tendance socialiste perçue comme crédible et réaliste.
Le premier point a été crucial. Des politiques réformistes ont eu parfois certains succès ces dernières années – et en tout cas assez pour faire croire à beaucoup de gens que le réformisme était une idée fiable.
Au fur et mesure que les conditions changent le deuxième point deviendra de plus en plus important et une trop grande insistance sur le concept de l’avant-garde peut devenir un réel obstacle au processus de fusion entre la tradition et les activistes.
Un des aspects négatifs du syndrome « direction/trahison » est la supposition que les réponses à toutes les questions sont connues d’avance. Elles se trouvent dans un programme qui est définitif et final. Sauvegarder la pureté du programme est considéré comme une des tâches principales d’un petit nombre d’ « élus ». Qu’il puisse y avoir de nouveaux problèmes qui demande de nouvelles solutions, qu’on doive apprendre de ses camarades de travail aussi bien que leur apprendre, sont des idées qui ne sont pas les bienvenues. Or, elles sont fondamentales. L’omniscience n’est pas plus accordée à des organisations qu’à des individus. Un degré de modestie et de souplesse et une conscience de ses limites sont indispensables.
Il est a priori assez peu probable qu’un programme écrit en, par exemple, 1938 contienne les réponses complètes aux questions posées dans les années 1970. Il est certainement vrai que, dans le processus de refondation d’un mouvement socialiste de masse, beaucoup de vieilles idées devront être modifiées. Les idées, en tout cas les idées utiles, fonctionnelles, ont toujours un rapport aux réalités et c’est une platitude de dire que le monde dans lequel nous opérons est en train de changer à une vitesse jamais atteinte auparavant.
En réalité, l’élaboration d’un programme, dans le sens d’une déclaration détaillée des objectifs et des tactiques partiels et transitionnels dans tous les domaines importants, ne peut être séparée du développement du mouvement lui-même. Elle suppose la participation d’un grand nombre de personnes qui se sont engagées activement dans ces domaines. La tâche des socialistes est de faire le lien entre leur théorie et leurs buts et les problèmes et l’expérience des militants afin de réaliser une synthèse qui est à la fois un guide pratique de l’action et un tremplin pour des avancées futures. Une telle synthèse n’a de sens que si elle sert de guide pour les participants dans la pratique et si elle est modifiée à la lumière de cette pratique et des changements de circonstances qui en sont le résultat. Ceci est la véritable signification de la « lutte pour le programme » qui est si souvent fétichisée.
Des considérations similaires s’appliquent à la question de l’internationalisme. L’internationalisme, la reconnaissance des intérêts communs à long terme des travailleurs de tous les pays et de la priorité de cet intérêt commun sur toutes les considérations sectorielles et nationales, est le b.a.-ba du socialisme. Aujourd’hui, avec le poids et l’influence croissants des multinationales, c’est plus évident que jamais. Il ne peut pas y avoir une organisation socialiste purement nationale. C’est un des grands mérites des groupes trotskistes d’avoir toujours insisté sur cette vérité fondamentale.
Mais la conclusion qu’on en tire souvent, qu’« on doit commencer par l’Internationale » est un autre exemple de la distorsion introduite par l’importance excessive accordée à la question de la « direction ». Une « Internationale » qui consiste en un assemblage de sectes dans différents pays est une pure fiction. Et c’est une fiction néfaste car, comme l’expérience nous l’a montré, elle est source d’illusions sur sa propre force et mène à une fuite en avant devant les vrais problèmes. La situation absurde où il n’existe pas moins de trois organisations, chacune prétendant être la « Quatrième Internationale », qui se balancent des anathèmes comme des papes médiévaux rivaux est une preuve suffisante de la faillite de l’ « ultra-avant-gardisme » dans le domaine international.
Pour créer un véritable courant internationaliste – et sans un tel courant tout discours sur l’Internationale est une illusion – il faut commencer par lier les luttes réelles des travailleurs d’un pays avec celles d’autres pays, des travailleurs chez Ford en Grande-Bretagne et en Allemagne par exemple, ou des dockers à Londres et à Rotterdam. Ceci signifie commencer là où les travailleurs existent vraiment, c’est-à-dire dans chaque pays, en mettant de côté des idées grandioses de « direction internationale », « congrès mondiaux » etc. Il faut donner la priorité aux tâches routinières de propagande et d’agitation dans son propre pays tout en développant des liens internationaux qui, quelques soient leurs limites au début, ont un sens réel pour les travailleurs qui ne gravitent pas autour des milieux sectaires.
Des rencontres et des discussions entre des groupuscules dans différents pays sont essentielles, la discussion théorique est indispensable mais ce qu’il nous faut avant tout est la création de véritables liens entre des groupes de travailleurs. Quand ceux-ci auront été établis sur une échelle importante, alors seulement à ce moment-là les conditions existeront pour la refondation de l’Internationale. Dans la situation actuelle, l’analogie avec Marx et la Première Internationale est d’une certaine façon plus adaptée que celle avec Lénine et la Troisième. Mais ni l’une ni l’autre ne nous donne un modèle à suivre à la lettre.
Bien sûr, quand on a fait le tri de tout ce qui ne vaut rien, il reste une graine importante de vérité dans l’analogie de l’ « avant-garde ». Cela repose sur la reconnaissance de l’extrême hétérogénéité du niveau de conscience, de confiance, d’expérience et d’activité des travailleurs. Une proportion assez réduite de la classe ouvrière est engagée, de façon conséquente, dans les activités des organisations ouvrières – et la composition de cette minorité ne cesse de changer. Une proportion plus importante s’engage de façon épisodique et la très grande majorité n’est entraînée que dans des circonstances exceptionnelles. De plus est, même quand un nombre assez considérable de travailleurs s’impliquent dans des actions, dans des grèves ou des mouvements contre les augmentations de loyers etc., il s’agit souvent d’actions sectorielles et limitées dans leurs objectifs. Même le fait de voter pour le parti considéré, d’une façon ou une autre, comme le parti des travailleurs, est devenu de plus en plus une action rituelle. A ce niveau il ne faut pas oublier qu’à chaque élection depuis la deuxième guerre mondiale environ le tiers de la classe ouvrière a voté pour le Parti conservateur...
Répéter ces faits très connus est parfois considéré comme une sorte de trahison, une diffamation à l’encontre de la classe ouvrière. Mais cela consiste simplement à dire non seulement ce qui existe, mais aussi ce qui doit exister pour que la société de classe capitaliste dans sa forme « démocratique » puisse continuer à exister. Une fois que des masses de gens commencent à agir directement, collectivement et de façon continue pour changer leurs conditions elles font plus que de changer elles-mêmes, elles minent la base même du capitalisme.
L’importance d’un parti est, d’abord, qu’il peut donner à la véritable avant-garde – la minorité la plus avancée et la plus consciente des travailleurs et pas les sectes ou dirigeants auto-proclamés – la confiance et la cohésion nécessaires pour emporter la masse avec eux. Il s’en suit qu’on ne peut pas parler d’un parti qui n’inclue pas cette minorité comme une des ses principales composantes.
Le problème de l’apathie doit être compris dans ce contexte. Comme on l’a souvent dit, l’essence de l’apathie est le sentiment d’impuissance, d’incapacité de changer le cours des événements autrement que de façon très marginale – ou pas du tout. La montée de l’apathie, l’augmentition de l’individualisme, sont naturellement très liées au déclin de la capacité des politiques réformistes de fournir des résultats concrets au fur et à mesure que le pouvoir des multinationales de contourner les restrictions nationales augmente. C’est la raison pour laquelle la tendance à l’apathie peut très rapidement être inversée si une alternative crédible peut être présentée aux travailleurs.
Cette alternative doit être plus qu’un simple rassemblement d’individus qui adhèrent de façon générale à une plateforme. Elle doit être en plus un lieu de formation et de débat communs, où le niveau de la nouvelle recrue tend à rattraper celui des membres les plus expérimentés, et où a lieu une fusion des expériences et de la conscience des travailleurs manuels et non-manuels et des intellectuels avec les idées du socialisme scientifique. Elle doit jouer le même rôle que ces institutions, écoles spéciales, universités, clubs, mess des officiers etc. dont dispose la classe dirigeante pour inculquer à ses propres cadres une vision du monde, une tradition et une fidélité communes. Et elle doit atteindre cet objectif sans couper ses militants de leurs camarades de travail.
La question de savoir si la conscience socialiste se développe « spontanément » parmi les travailleurs ou si elle leur est imposée par des intellectuels depuis l’ « extérieur » (question qui est souvent utilisée pour faire diversion) n’a strictement aucun intérêt dans les conditions d’aujourd’hui. Elle suppose l’existence chez la classe ouvrière d’une vision plus ou moins autonome du monde dans laquelle quelque chose est injectée. On peut se demander si cette vision relativement homogène, décrite de façon quasi romantique par des auteurs comme [Richard] Hoggart, a jamais existé. En tout cas, elle est morte, tuée par des changements sociaux et surtout par les mass-média. Il est assez absurde de se disputer pour savoir si on devrait apporter des idées de l’ « extérieur » à des travailleurs qui ont tous des postes de télévision. Il est sûr que la plupart des travailleurs et surtout les activistes voient le monde différemment de ceux qui habitent les banlieues résidentielles. Toute leur expérience de la vie le garantit. Mais les travailleurs ne sont pas des automates qui réagissent passivement à leur environnement. Tout le monde doit se former une vision du monde, un cadre de référence dans lequel des données sont insérées, quelques idées pré-établies sur la société.
Tout l’appareil immense des communications de masse, le système d’éducation et le reste ont parmi leurs fonctions principales ce que les sociologues appellent la « socialisation » et ce que les vieux Wobblies [membres des Industrial Workers of the World, un mouvement anarcho-syndicaliste américain du début du 20ème siècle, NDLR] appellaient le « head-fixing » [« lavage de cerveau », NDLR]. Les suppositions qui vont dans le sens des intérêts de la classe dirigeantes font partie des idées que nous « consommons » tous les jours. Les individus, qu’ils soient chauffeurs d’autobus ou professeurs d’esthétique, ne peuvent résister à ce conditionnement intellectuel que jusqu’à un certain point. Seul un groupe formant une collectivité peut développer une vision alternative systématique du monde, peut surmonter dans une certaine mesure l’aliénation du travail manuel et intellectuel qui impose à tous, intellectuels comme ouvriers, une vision partielle et fragmentée de la réalité. Ce que Rosa Luxemburg appelait « la fusion de la science et des travailleurs » est impensable en dehors d’un parti révolutionnaire.
Un tel parti ne peut être créé que sur des bases profondément démocratiques. Si, dans sa vie interne, la controverse vigoureuse et la représentation de différentes tendances et nuances n’est pas la règle, un parti socialiste révolutionnaire ne peut pas s’élever au-dessus du niveau d’une secte. La démocratie interne n’est pas un luxe dont on peut se passer. Elle est fondamentale pour les rapports entre les membres du parti eux-mêmes et avec ceux parmi lesquels ils travaillent.
Ce point a été bien illustré par [l’historien marxiste d’origine polonaise, NDLR] Isaac Deutscher dans une discussion des partis commmunistes à la fin des années vingt et au début des années trente : « Quand le communiste européen avait à défendre ses idées devant un auditoire de travailleurs, il y rencontrait généralement un opposant social-démocrate dont il devait réfuter les les arguments et contrer les slogans. Le plus souvent il en était incapable parce qu’il n’était pas habitué au débat politique qui n’était pas cultivé au sein du parti, et parce que sa formation le rendait incapable de prêcher à d’autres que des convertis. Il ne pouvait pas s’attaquer en profondeur aux arguments de son opposant parce qu’il devait penser sans arrêt à sa propre orthodoxie. /…/ Il était capable de proposer avec un fanatisme mécanique une liste d’arguments et de slogans qui lui étaient préscrits. /…/ Lorsqu’on lui demandait, comme on le faisait souvent, de répondre aux critiques sur l’Union Soviétique, il pouvait rarement le faire de façon convaincante, ses prières de remerciement à la patrie des travailleurs et ses hosannas pour Staline le couvraient de ridicule aux yeux de gens qui avaient un tant soit peu la tête sur les épaules. Cette inefficacité de l’agitation stalinienne fut une des raisons pour laquelle, au bout de nombreuses années, même dans les circonstances les plus favorables, elle ne parvint que très peu ou pas du tout à marquer des points contre le réformisme social-démocrate. » Nous connaissons tous des exemples plus récents de ce phénomène.
L’auto-formation des militants est impossible dans une atmosphère d’orthodoxie stérile. L’autonomie et la confiance en ses propres idées se développent au cours du débat authentique qui a lieu dans une atmosphère où les différences sont exprimées librement et de façon ouverte. Le « parti monolithique » est un concept stalinien. L’uniformité est incompatible avec la démocratie.
Naturellement le parti ne peut être un fourre-tout à l’intérieur duquel n’importe quelle opinion est représentée. Tous les membres du parti doivent avoir comme but le contrôle démocratique et collectif par la classe ouvrière sur l’industrie et la société. Ceci dit, l’existence d’opinions divergentes sur différents aspects de la stratégie et de la tactique est nécessaire et inévitable dans une organisation démocratique. La tendance à la « chasse aux sorcières » qui caractérise certaines sectes est contre-productive ; une ambiance de fanatisme quasi religieux est incompatible avec la réintégration de la tradition socialiste dans le mouvement ouvrier au sens large.
La discipline qui est certainement nécessaire dans n’importe quelle organisation sérieuse peut être créée de deux façons différentes. Elle peut prendre la forme d’une unanimité artificielle imposée par des ordres et des prescriptions – un système qui est en fait contre-productif dans un groupe socialiste. Ou elle peut prendre corps à partir d’une tradition et d’une fidélité communes construites sur la base d’un travail commun, une formation partagée et un rapport réaliste et responsable aux actions spontanées des travailleurs.
La spontanéité est un fait. Mais qu’est-ce qu’elle signifie ? Tout simplement que des groupes de travailleurs qui ne militent pas au sein d’une organisation politique (voire syndicale) agissent pour leur propre compte ou pour soutenir d’autres groupes. Du point de vue des organisations leur action est « spontanée » ; du point de vue des travailleurs concernés elle est consciente et délibérée. De telles actions ont lieu tout le temps ; elles sont le reflet de l’aspiration à l’autonomie qui est très répandue même chez des travailleurs qu’on considère souvent comme « arriérés ». Elles sont une expression élémentaire de la lutte de classe. Sans de telles actions les militants conscients seraient comme suspendus dans le vide. Pour utiliser une analogie banale mais utile, elles sont la vapeur qui pousse les pistons de l’organisation de la classe ouvrière.
Les pistons sont inutiles sans énergie. La vapeur qui n’est pas canalisée n’a que des effets limités. La spontanéité et l’organisation ne sont pas mutuellement exclusives ; ce sont des aspects différents du processus à travers lequel un nombre croissant de travailleurs arrivent à la conscience de la réalité de leur situation et du pouvoir qu’ils possèdent de la changer. La maturation de ce processus dépend d’un dialogue, de militants organisés qui argumentent mais qui écoutent également, qui comprennent aussi bien les limites d’un parti que sa force et qui sont capables de trouver des liens entre la conscience réelle de leur camarades et la politique qui est nécessaire pour réaliser les aspirations enfouies dans cette conscience.
Il peut arriver que même les meilleurs militants se trouvent dans une situation où ils sont dépassés par les événements et occupent une position, pour un temps plus ou moins long, à la droite de travailleurs qui n’avaient jusque-là pas fait preuve de combativité. Les militants syndicaux de base connaissent bien cette situation. Des mots d’ordre et des revendications qui hier n’étaient acceptables qu’aux gens relativement conscients peuvent assez rapidement devenir trop limités pour la majorité quand une lutte se développe au-dela de ce qu’on attendait. Il est inévitable que la plus grande expérience et les meilleures connaissances des militants encouragent une certaine prudence, justifiée dans des conditions « normales », mais qui, lorsque la situation change rapidement, peut devenir un réel obstacle au mouvement. La même tendance existe logiquement pour une organisation. C’est cela l’élément valide dans la critique de Cohn-Bendit des partis socialistes.
Ce danger est inhérent à la nature même du milieu. Des changements soudains de conscience dans un groupe ou un autre ne peuvent pas toujours – ni même souvent – être prédits. Ce qu’on peut préconiser est le besoin d’être suffisament sensible à ces changements afin de les détecter rapidement et assez souple afin de réagir de la façon la plus adaptée.
Ni l’existence de tels changements spontanés d’atmosphère, de bouleversements inattendus, ni le fait que les militants socialistes expérimentés et convaincus tendent à la prudence, ne constituent un argument contre le parti. Au contraire, vu l’hétérogénéité de la conscience et les divisions professionnelles et géographiques entre différentes sections de la classe ouvrière, un parti – et un parti centralisé – est essentiel pour donner aux diverses actions des différents groupes une cohésion et une coordination sans lesquelles leurs effets seront limités à des victoires locales et sectorielles.
C’est un argument contre la caricature bureaucratique d’un parti dont le stalinisme est responsable et qui n’a rien à voir avec un vrai parti révolutionnaire. Une des illustrations du conservatisme du parti choisie par Cohn-Bendit, le fait qu’en juillet 1917 le Parti bolchevique fut moins avancé que les ouvriers de Petrograd et essaya de restreindre et de limiter leur manifestations, éclaire ce point. Le parti était dans un dilemme qui est inhérent au développement inégal du mouvement en Russie. Comme l’écrivait Trotsky, « la crainte existait que Petrograd pourrait se trouver isolé des provinces les moins avancées ; de l’autre côté il y avait l’espoir qu’une intervention active et énergique par petrograd pourrait sauver la situation ». [Traduction de la rédaction]. Ce « conservatisme » fut le reflet de la pression venant des membres du parti dans d’autres centres qui, à leur tour, transmettaient l’ambiance de leurs milieux ouvriers dans ces centres. Le fait qu’il existait un parti suffisamment souple pour réagir à cette pression empêcha probablement en 1917 une répétition de la Commune de Paris. Ceci était, bien sûr, la situation la plus extrême qu’on puisse imaginer, mais des problèmes similaires sont inévitables à chaque stade de développement.
Un parti socialiste révolutionnaire est donc nécessaire ; mais le besoin d’un tel parti existe depuis longtemps. Qu’est-ce qui nous fait penser qu’il serait possible de le créer dans les années 1970 ?
Essentiellement la justification de cette possibilité se trouve dans l’analyse de la crise mondiale que nous avons développée dans la revue International Socialism, et notamment dans la thèse selon laquelle, avec l’évolution actuelle du capitalisme, les politiques réformistes seront de moins en moins capables de fournir mêmes les solutions partielles aux problèmes de la classe ouvrière, comme cela a été le cas depuis le Deuxième Guerre Mondiale. Ceci est la facteur objectif.
Le facteur subjectif le plus important est le déclin du pouvoir idéologique du stalinisme. L’influence passée du stalinisme sur la gauche et ses effets, à la fois directs et en réaction, qui ont effectivement rendu impossible la construction d’une alternative, ne doivent jamais être minimisés. Depuis 15 ans [depuis le milieu des années 1950] ce pouvoir s’est petit à petit effrité, lentement au début et ensuite de plus en plus rapidement. Aujourd’hui il est en plein délitement. Cette décomposition idéologique ne doit pas être confondue avec le déclin organisationnel des partis communistes. Bien que le Parti Communiste britannique soit bel et bien entré dans une période de déclin, ceci n’est pas la considération décisive. Le Parti bénéficie encore de la fidélité de bon nombre de militants industriels. Mais cette fidélité a changé de nature. Le Parti n’est plus un parti stalinien. Toutes sortes de tendances existent en son sein et avec la disparition de l’infaillibilité papale de Moscou le parti monolithique ne peut jamais être restauré.
Le groupe dominant dans le Parti, la direction autour de [John] Gollan [secrétaire-général du PC britannique à l’époque, NDLR], est effectivement réformiste. Que cette direction vise à liquider le Parti dans le Parti Travailliste comme certains de ses critiques le soupçonnent, ou qu’elle s’accroche à l’illusion qu’il existe un espace politique en Grande-Bretagne pour un deuxième parti ouvrier réformiste (ce qui semble l’hypothèse la plus probable), ne change pas grande chose. Comme obstacle au regroupement de la gauche le Parti est une force en déclin rapide.
La gauche du Parti Travailliste n’a pas l’influence qu’elle exercait par le passé, non plus. En partie, ceci est le reflet du déclin du Parti Communiste, car l’aile gauche du Parti Travailliste, quand elle a été influente, a toujours compté sur la base syndicale du Parti Communiste. En partie, c’est le résultat du déclin des organisations de masse du Parti Travailliste – le mouvement de la jeunesse, les comités de quartier et de circonscription – qui s’est accéléré ces dernières années. Il reste des socialistes authentiques qui sont actifs au sein du Parti Travailliste, et d’autres plus passifs qui se contentent de prendre la carte du Parti. Mais il semble peu probable, même si cela n’est pas inconcevable, qu’un courant socialiste d’une certaine importance puisse se développer dans le Parti.
Les bases pour la construction d’un parti socialiste révolutionnaire existent parmi les travailleurs industriels qui autrefois s’orientaient vers le Parti communiste, parmi un nombre croissant de jeunes travailleurs et d’étudiants radicalisés et parmi les groupes révolutionnaires.
Ces derniers constituent un problème important mais difficile à résoudre. L’origine du sectarisme dont souffre la gauche britannique est l’isolement des socialistes et leur impossiblité d’influencer et de participer réellement aux luttes de masse. Cet isolement est en train de diminuer rapidement mais ses effects négatifs – l’exacerbation des différences secondaires, la transformation de divergences tactiques en questions de principe, le fanatisme semi-religieux qui peut permettre à un groupe de survivre dans des conditions difficiles au risque de limiter son potentiel de développement, le conservatisme théorique et l’aveuglement face à des aspects de la réalité quand ceux-ci ne sont pas les bienvenus – toutes ces caractéristiques continuent à exister. Elles ne seront dépassées que par la pénétration et la fusion de couches considérables de travailleurs et d’étudiants en dehors des milieux sectaires. Le groupe International Socialisme entend contribuer de façon significative à cette pénétration. Sans entretenir d’illusion qu’il est la « direction », la raison d’être du groupe est de contribuer à la régénération théorique et pratique du socialisme en Grande-Bretagne et dans le monde.
Note (1) Ce chiffre et ceux qui suivent sont de E.H. Carr, La révolution bolchevique, tome 2.
Note de la rédaction : Cet article fut publié pour la première fois dans la brochure Party and Class, Pluto Press, Londres, 1971. La présente traduction est de Claude Meunier, Socialisme International, 2002. Les intertitres sont de la rédaction.


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F57%2F494997%2F129641032_o.gif)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F62%2F494997%2F126696163_o.jpg)