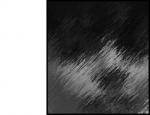Le Capitalisme au XXIe siècle
CONCURRENCE, GUERRES, RESISTANCES
« La falsification et la fraude détruisent le capitalisme et la liberté de marché, et plus largement les fondements de notre société. » Tel est le constat qu’Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale, la banque centrale des Etats-Unis, a dressé en juillet 2002 devant une commission du sénat. Dans Le Monde daté du mardi 2 décembre, un an après la faillite d’Enron et la débâcle boursière, l’ancien président de la SEC (commission qui surveille les marchés financiers américains) reconnaît : « La culture des patrons s’est résumée, avec l’euphorie boursière, à prendre au passage tout ce qu’ils pouvaient plutôt qu’à se préoccuper de l’intérêt des actionnaires et des salariés. »
Y-aurait-il quelque chose de pourri au royaume du capitalisme ? Le même Greenspan, toujours devant le sénat, répond : « Si nous réglons le problème des PDG, les autres problèmes disparaîtront. » Le président Bush a devancé ses attentes en annonçant quelques jours plus tôt « une nouvelle éthique qui augmentera la confiance des investisseurs, rendra les salariés fiers de leurs entreprises et redonnera confiance au peuple américain.? »
Personne ne peut nier la crise de confiance provoquée
par les scandales financiers et boursiers. Cela n’est pas une explication
suffisante. Car le ralentissement de l’économie mondiale, qui a
suivi les scandales et le krach boursier, n’est pas le produit de la «
malhonnêteté » de quelques patrons.
Pas plus que l’organisation économique, les mots
ne sont pas neutres. Nous pensons que pour parler d’économie, il
ne suffit pas de s’intéresser à la croissance du PIB, aux
cours de bourse, etc. Des notions comme le taux de profit, la productivité
du capital, ou encore les rapports de force entre les classes, sont essentielles.
Le moteur du capitalisme c’est la concurrence, hier comme aujourd’hui, entre capitalistes. C’est la recherche du profit (toujours plus) qui fait courir le système. Pour réaliser des profits, il faut produire et vendre des marchandises. Nous devons garder à l’esprit que les profits, la plus-value, proviennent de l’exploitation de la classe des salariés, qui produisent les biens et services.
Pour comprendre ce qui se passe dans le système nous devons en analyser concrètement les principaux aspects. Nous nous intéresserons à la situation économique et sociale des trois grands centres capitalistes que sont les Etats-Unis, le Japon et l’Europe. Puis nous aborderons les autres régions du globe, leurs relations avec les grandes puissances et les effets de la « mondialisation » sur leurs économies. Enfin, nous essaierons de dégager les grandes tendances du capitalisme au 21e siècle, entre-t-il dans une « nouvelle phase » ou assiste-t-on à la continuation de processus anciens ?
Les grands centres capitalistes
: entre stagnation et croissance molle
Du point de vue de la croissance économique et par rapport à la période des années 1970, la situation des trois centres s’est modifiée. Les Etats-Unis et l’Europe semblent sortis de la crise, tandis que le Japon, en pleine croissance jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, oscille depuis 1991 entre récession et stagnation.
Les Etats-Unis ont commencé la dernière
décennie du 20e siècle sous le signe de la récession,
avant de connaître, à partir de 1992, la plus forte croissance
depuis celle des « Trente glorieuses ». Les économies
européennes ont suivi le même chemin mais à un rythme
plus lent.
Toujours par rapport à la période des années
soixante-dix, nous avons assisté à la restauration des profits,
à l’envol des bourses, sur fonds de fusions, de concentrations et
de privatisations.
Les courbes de la croissance économique et celle des cours des bourses ont été soutenues à la hausse par plusieurs facteurs. Tout d’abord, il y a eu un afflux continu de capitaux étrangers vers les marchés financiers américains principalement. Chaque année, des centaines de milliards de dollars se sont investis en provenance de l’économie parallèle (drogue…) et des plus-value contrôlées par les classes capitalistes de toutes les régions du globe. Ils ont constitué le carburant.
Le moteur de la croissance a été la remontée de la productivité du capital et du taux de profit, cette tendance est apparue au milieu des années quatre-vingts et a mis un terme à la baisse enregistrée au cours de la crise des années soixante-dix2. Cette remontée s’explique d’une part par la hausse de la productivité du travail (même si son taux de croissance tend à diminuer) et d’autre part par la quasi-stagnation du coût du travail en général, et un contrôle strict des salaires. Les nouvelles technologies de l’information ont joué un rôle essentiel dans la gestion des entreprises, au point où l’on peut parler d’une révolution dans la gestion. Cela a représenté un gain d’efficacité dans l’utilisation du capital, et donc a accru sa productivité. Mais la « révolution » informatique n’a été qu’un outil, nous y reviendrons.
Les Etats-Unis : le cœur du système
En tant que seule grande puissance militaire et économique, les Etats-Unis ont été les initiateurs des changements intervenus dans l’économie mondiale, ils en ont donc retiré la majeure partie des bénéfices. La période 1992-2000 de croissance a été portée par la restauration du taux de profit et de la productivité du capital. Dans le même temps, les cours des bourses ont eux augmenté dans des proportions gigantesques : le Dow Jones, l’indice des valeurs « traditionnelles », s’est adjugé 347 % et le Nasdaq plus de 900 %.
Pour une part, cette croissance s’est faite à crédit, les taux d’intérêt ont été révisés à la baisse systématiquement pour soutenir la consommation et l’investissement. Le résultat, c’est un endettement massif des ménages, des entreprises et de l’Etat qui atteint 32 000 milliards de dollars.
Surtout, le fait que la part du capital augmente au détriment de la part du travail dans la richesse nationale, est le fruit des défaites infligées aux salariés américains au début des années quatre-vingts. De leur point de vue, cela s’est traduit par une intensification du travail (flexibilité et précarisation). Le salaire réel, aujourd’hui, reste en dessous de la moyenne des années 1970. Si l’on regarde la durée du travail entre 1980 et 1997, elle diminue dans tous les pays développés, sauf aux Etats-Unis, où elle passe de 1883 à 1966 heures annuelles.
Relance budgétaire massive
En 2001, l’économie est entrée en récession durant trois trimestres consécutifs. En 2002 une reprise s’est amorcée mais très vite elle s’est essoufflée, s’établissant à 2,5 % pour l’année. Pour 2003, le taux de croissance, selon l’OCDE, devrait s’élever à 2,6 %. Mais la guerre à venir en Irak peut influer à la baisse ou à la hausse sur cette croissance. La première guerre du Golfe avait accéléré la récession de la fin des années quatre-vingts aux Etats-Unis.
Depuis son installation à la Maison blanche, l’équipe de Bush junior a décidé de soutenir l’économie par des baisses d’impôt massives et une relance des dépenses militaires. En deux ans, 2001 et 2002, ce sont cent milliards de dollars de baisse d’impôt que les ménages et les entreprises ont reçu. Au début de l’année, Bush a annoncé de nouvelles réductions fiscales pour plus de 600 milliards sur dix ans. La mesure centrale est la suppression de l’impôt sur les dividendes, que les entreprises versent à leurs actionnaires, son coût est de 300 milliards. Le quotidien Le Monde, dans son édition du 9 janvier 2003, précise que cette suppression concernera 35 millions d’Américains, détenteurs d’actions, et parmi eux, 1 % bénéficiera de 42 % de la réduction ! Le but est de soutenir les cours de la bourse.
Relance des dépenses militaires
Avant le 11 septembre 2001, le gouvernement avait opté pour l’accroissement des dépenses militaires, poursuivant l’effort entamé dès 1998 par Clinton. Le budget du Département de la Défense pour l’année 2003 s’élève à 379 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente. La hausse va se poursuivre, et n’est donc pas conjoncturelle, pour atteindre plus de 450 milliards en 2007.
Ce qui correspondra à une hausse de plus de 75 % pour la décennie 1997-2007. Les dépenses militaires actuelles représentent 2,8 % du PIB américain (contre une moyenne de 1,4 % pour les grands pays européens) et plus du tiers des dépenses mondiales d’armement.
Les dépenses militaires sont improductives (tôt ou tard la production militaire est détruite, par la guerre ou l’obsolescence), mais l’état garantit le profit des marchands de canons et apporte par la même occasion un soutien à l’ensemble de l’activité économique. C’est une force d’entraînement de l’économie. Le rôle des dépenses militaires est par ailleurs déterminant dans le secteur de la recherche. A son tour, la technologie influe sur l’activité économique, le réseau Internet en est le meilleur exemple.
Le militarisme est un phénomène structurel dans le système capitaliste. La guerre joue un rôle stabilisateur, en détruisant des richesses, donc en évitant les crises de surproduction (problème inconnu avant l’ère industrielle). La période faste du capitalisme, les « trente glorieuses », s’est développée après la guerre la plus destructrice du 20e siècle, la Seconde guerre mondiale.
L’augmentation quasi constante des dépenses militaires s’explique en partie par la croissance des coûts d’entretien et de recherche. Les armements sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus coûteux à concevoir puis à entretenir.
Mais c’est surtout lorsque l’on compare la relance actuelle avec le programme de Reagan (les dépenses ont alors augmenté de 60 % en cinq ans, 1980-1985), que l’on constate ses limites.
Les premiers résultats de cette politique a été la fin des excédents budgétaires, le solde est passé de + 1,4 % en 2000 à un déficit de 3 % du PIB en 2002.
Le dollar et l’exportation de la crise
Pour soutenir les entreprises américaines, une partie des dirigeants milite pour une baisse du dollar qui permettrait de favoriser les exportations. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, puisque les comptes extérieurs sont déficitaires. Mais cette baisse du dollar implique le renforcement de l’euro et du yen, et donc une pénalisation des exportations pour le Japon et l’Europe. Dans le même temps, il y a le problème du déficit budgétaire, qui va aller en s’aggravant (baisse des impôts). Pour le financer, les Etats-Unis ont fait appel aux autres pays, notamment le Japon qui détient une part de la dette publique. Aujourd’hui, cela implique de relever les taux d’intérêts, que la banque centrale a baissé précisément pour soutenir la croissance, la consommation et l’investissement.
La classe dirigeante américaine, par sa position dans l’économie mondiale, dispose d’une marge de manœuvre importante. Suffisante, en tout cas pour relancer son économie, fut-ce au détriment du reste du monde. Mais les contradictions ne manquent pas au sein de l’économie américaine et les facteurs extérieurs ont aussi leur part à jouer.
Le Japon : décennie « perdue »
L’économie japonaise est en panne depuis l’éclatement de la bulle spéculative en 1991 dans le secteur immobilier. Les banques, qui sont un élément clé du capitalisme nippon, ont été touchées de plein fouet avec des centaines de milliards de créances douteuses.
Les gouvernements ont multiplié les plans de relance budgétaires massifs, sans parvenir à ranimer l’économie. Pour une large part, cet échec s’explique par l’absence d’un marché intérieur large (comparable au marché domestique américain). La structure économique du pays est axée sur une « austérité exportatrice »3. Le pays est devenu une puissance commerciale, il a conquis des positions dans l’économie mondiale, notamment durant les années soixante-dix et quatre-vingts. Le revers de la médaille du mode de développement japonais, c’est la faiblesse de l’appareil impérialiste.
Ces éléments placent les capitalistes japonais en position de dépendance vis-à-vis de leur « partenaire » et protecteur. Et Washington ne se prive pas de faire pression sur Tokyo pour l’ouverture de son marché intérieur. Déjà l’industrie automobile est passée sous contrôle étranger (sur 9 entreprises, 2 restent « nationales »).
L’Europe : à la croisée
des chemins ?
Lorsque le ralentissement économique s’est amorcé aux Etats-Unis, certains analystes nous ont annoncé que l’Union européenne avait les moyens de les remplacer comme locomotive de la croissance mondiale. Mais rien de tel ne s’est produit. L’Allemagne voit son économie stagner (0,2 % en 2002, après 0,5 % en 2001 et 3 % en 2000), en France la croissance est à la peine (1,5 % annoncés pour 2003). L’Angleterre, elle, se distingue par une croissance soutenue de l’ordre de 4 %.
La mise en place de l’euro est une étape supplémentaire
dans la construction d’un bloc capitaliste, capable, à terme, de
rivaliser avec l’Amérique du Nord. Les capitalistes européens
ont un projet alternatif face aux visées de l’impérialisme
américain. Cependant, ce n’est pas encore un bloc impérialiste
unifié, il n’y a pas de gouvernement central.
Le projet est écartelé entre d’une part
la volonté des classes dirigeantes de s’unir (gouvernement supranational)
pour mieux résister et d’autre part les rivalités entre vieilles
nations impérialistes (France, Angleterre, Allemagne, Italie…).
Enfin, pour parvenir à leurs fins, les dirigeants européens
doivent obtenir de larges concessions des salariés.
A la différence de leurs homologues américains, la situation des travailleurs européens est bien plus favorable. Comme aux Etats-Unis, il y a eu des reculs et des revers (en Angleterre, aux Pays-Bas et en Espagne) mais nous avons aussi assisté à des résistances de la part des salariés, qui ont pu faire reculer certains gouvernements (Italie et France).
Surtout, nous parlons du mouvement ouvrier (au sens large de travailleurs) le mieux organisé, avec la plus vieille tradition politique, et qui a les conquêtes sociales les plus avancées4. Les gouvernements actuels cherchent à rééditer la politique de Thatcher dans les années quatre-vingts en Angleterre à l’échelle du continent. Rien n’est moins sûr que le succès dans cette entreprise. Une grande partie va se jouer dans les mois et les années à venir
Capitalisme « mondialisé
» : « globalivernes » et réalités
Pour les partisans du système, la « mondialisation » est un mouvement inéluctable et naturel, tous les pays peuvent en tirer profit pour peu qu’ils s’en donnent les moyens. Les discours sur la « nouvelle économie » sont peu ou prou du même ordre. Les technologies de l’information et de la communication représenteraient une nouvelle « révolution industrielle », porteuse d’une ère de croissance économique inconnue jusqu’alors.
Quelle est la part de l’idéologie et quelle est la part de réalité dans ces affirmations ? Au 19e siècle, les libéraux refusaient (et refusent toujours) de reconnaître les crises économiques comme un produit du capitalisme. Comme l’a si bien dit Marx, c’est la même attitude que celle de la « vierge folle » qui traîne son enfant derrière elle en déclarant qu’il n’est pas le sien. Aujourd’hui comme hier, il n’y a pas lieu de prendre les vessies libérales pour des lanternes.
Si on jette un regard sur les vingt dernières années du développement économique de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine, force est de constater que la « mondialisation » n’a pas apporté que des bienfaits. La crise, qui sévit dans une partie de l’Amérique latine, est le nouvel épisode d’une longue suite d’effondrement depuis le Mexique en 1995, l’Asie du Sud-Est en 1997 (Thaïlande, Corée du Sud, Malaisie, etc.), la Russie et le Brésil en 1998, l’Indonésie en 1999 et en 2001 la Turquie.
On peut néanmoins identifier plusieurs changements notables durant les vingt dernières années écoulées : croissance du commerce international et surtout des flux financiers (tandis que la production a augmenté beaucoup plus lentement), une nouvelle division internationale du travail, et le poids pris par les institutions supranationales dans les relations internationales. Par ailleurs, la libéralisation et la dérégulation ont contribué à aiguiser encore plus la concurrence inter capitalistes, inter étatiques et entre salariés.
Nouvelle phase de l’expansion impérialiste
Cependant, dire que la « mondialisation » du capital est un phénomène nouveau, est une absurdité. Le capitalisme est un système mondial et national depuis ses débuts. Depuis le XVIe siècle, le commerce s’organise sur une base internationale, d’abord commerce de luxe, il est devenu, avec le développement industriel, un commerce de masse au XIXe et au XXe siècles.
La liberté pour les capitaux de se déplacer d’un bout à l’autre de la planète est assurément un changement par rapport à la période antérieure. Ensuite, les flux financiers, pour l’essentiel, ont connu un double mouvement vers le haut et vers l’extérieur. Les capitaux comme les profits se sont concentrés dans beaucoup de pays aux mains d’une élite restreinte (vers le haut), et se sont investis majoritairement dans les pays développés (vers l’extérieur, de l’Amérique du Sud, de l’Asie vers les grands centres).
Les grandes compagnies de la triade - Amérique du Nord, Union européenne et Japon - étaient dominantes dans les années soixante-dix, elles le sont restées et se sont même renforcées, sauf les sociétés asiatiques qui sont en recul. Les privatisations dans le tiers-monde ont permis aux entreprises du Nord de s’implanter sur les marchés nationaux de tous les continents. Les crises financières ont joué le même rôle. Ainsi, en Amérique latine, les secteurs de l’énergie et des télécommunications sont passés sous le contrôle de capitaux nord-américains et européens.
Relations Nord-Sud : domination impérialiste
Si en 1950, à l’échelle mondiale, les travailleurs salariés de l’industrie, des services, etc., représentaient une minorité par rapport à une population rurale ; aujourd’hui la donne a changé. Les salariés étaient au nombre de deux milliards à la fin des années quatre-vingts, et autour de 3 milliards au milieu des années quatre-vingt-dix6. Plus de 50 % de ces salariés sont sous-employés, au chômage ou dans l’économie informelle.
Au cours du troisième quart du 20e siècle, une nouvelle division internationale du travail s’est opérée. L’Amérique latine et une partie de l’Asie ont connu un développement industriel important, tandis que certains pays tiraient profit de leurs ressources énergétiques (Moyen Orient). Cela s’est poursuivi sur les vingt dernières années avec quelques changements. Un mouvement s’est opéré, déplaçant les industries employant de la main d’œuvre peu qualifiée (comme le textile ou l’électronique) des pays du Nord vers certains pays à bas salaires. Les délocalisations, comme l’accroissement des réserves de main d’œuvre (« armée de réserve »), comme la course aux bas salaires, est le fruit de l’affaiblissement organisationnel (syndicats et partis) des travailleurs.
Il faut ajouter l’emprise des firmes capitalistes sur l’agriculture du tiers-monde, qui a entraîné l’exode rural, gonflant d’autant les rangs des travailleurs précaires.
Juste avant la crise de 1997, les « dragons » d’Asie du Sud-Est (Singapour, Corée du Sud, Thaïlande, etc.) étaient présentés comme les nouveaux pays « émergents ». Puis ce fut le tour de pays d’Amérique latine d’être cité en exemple, comme l’Argentine, le « bon élève ». Ces « modèles » ont fait long feu. L’Argentine est entrée dans une crise sociale et économique au point où l’on peut parler d’un effondrement, qui a des répercussions sur toute la zone. L’Asie, hors Japon, a retrouvé la croissance à un rythme soutenu. Le redémarrage de l’Asie du Sud-Est s’explique en partie par la croissance du marché intérieur chinois (en plein boom et appelé à se développer plus encore) qui absorbe une part de plus en plus importante des exportations des « dragons ».
La création de nouveaux centres d’accumulation (les pays « émergents ») dans les pays du Sud n’a pas modifié la donne de la domination du Nord. De même, les grands centres capitalistes sont de moins en moins dépendants des pays producteurs de matières premières (énergétiques, agricoles, etc.), dans la mesure où leurs échanges commerciaux sont centrés sur des produits manufacturés et à haute « teneur informationnelle ». Cela est évident quand on regarde le cas de l’Afrique, qui vit toujours à l’heure du néocolonialisme, mais est aussi valable pour l’Amérique et l’Asie.
La « nouvelle économie » est censée apporter une nouvelle période de croissance soutenue. Or, ce concept n’a de réalité, pour l’essentiel, qu’aux Etats-Unis7, qui absorbent 60 % du marché mondial des ordinateurs. A son maximum, l’économie américaine n’a vu sa croissance que d’environ 4-5 % les meilleures années. Elles sont à mettre en perspective avec les taux de croissance de la Chine, 7 – 8 % en moyenne cette année, contre un taux de 10 % dans les années quatre-vingt-dix.
Les délocalisations ne se font plus que du Nord vers le Sud, ainsi Taiwan délocalise ses usines informatiques en Chine. Les délocalisations touchent aussi ces industries de l’informatique et de la téléphonie, surtout depuis les vingt dernières années. La course aux bas salaires a ses limites, tôt ou tard (toujours trop tôt pour le patron), les travailleurs s’organisent réclamant des hausses des salaires. Le coût du travail tend alors à augmenter.
Les critiques des grandes organisations internationales leur reprochent d’aggraver les crises quand elles existent ou de les provoquer. Cela est peut-être vrai. Mais du point de vue capitaliste, les grandes institutions jouent un rôle stabilisateur. Les exigences du FMI, vis-à-vis de tel pays, visent, entre autre, à s’assurer du remboursement de la dette, détenue par les financiers du Nord.
Le rôle stabilisateur des grands organismes financiers internationaux (FMI-BM-BIRD) doit être souligné. Si en 1929, les dirigeants tant politiques qu’économiques ont été dépassés, comme si le ciel leur tombait sur la tête, ils ont appris depuis. Depuis les années quatre-vingts, il y a eu pas moins de quatre grandes secousses sur les marchés financiers nord-américains, dont le krach de 1987, comparable à celui de 1929. Pourtant, à chaque fois, le pire a été évité.
Ce qui est vrai, c’est qu’au travers des institutions internationales c’est la volonté des grandes puissances qui dominent (les pays du G7). La place et le rôle pris par les organismes internationaux expriment la volonté politique des dirigeants des grands centres capitalistes de donner forme et contenu à la « mondialisation ». En face les pays « émergents » ou non sont en position de dépendance.
Quel capitalisme au 21e siècle
? Une nouvelle phase ?
Avant de voir précisément quelles sont les tendances et les transformations qui sont à l’œuvre dans le capitalisme contemporain, il est nécessaire de faire une remarque sur la crise boursière et les commentaires journalistiques sur les centaines de milliards « partis en fumée ».
Les milliards qui sont partis en fumée étaient virtuels, fictifs. Marx avait décrit cette propriété du capital argent : « Les titres établissent seulement des droits sur une fraction de la plus-value qu’il (le capitaliste) va s’approprier. Mais ces titres se transforment eux aussi en duplicata du capital réel, en chiffons de papier, comme si un certificat de chargement pouvait avoir une valeur à côté du chargement, et en même temps que lui. Ils se transforment en représentants nominaux de capitaux qui n’existent pas […] en tant que duplicata, négociables eux-mêmes comme marchandises et circulant donc comme valeur-capital, leur valeur est fictive : elle peut augmenter ou diminuer tout à fait indépendamment du mouvement de valeur du capital réel, sur lesquels leurs détenteurs ont un droit. 8»
C’est ce que Marx appelait le fétichisme de l’argent, l’idée que l’on peut faire de l’argent avec de l’argent, que l’on peut se passer du processus de production. La richesse est produite par le travail humain, pas par des bouts de papier échangés par des courtiers.
Le rôle de la finance associée aux institutions internationales a été déterminant dans la vague de libéralisation des marchés, de démantèlement des protections sociales et de captation des richesses. Mais le capital financier ne peut se passer des autres formes de capital, que sont les marchandises et l’appareil productif9. Le capital-argent est un facteur d’instabilité en raison de sa volatilité.
Etat et capital au 21e siècle
Avec les inepties sur la « mondialisation », les néolibéraux nous ont aussi annoncé la fin de l’Etat. Mais comme nous l’avons indiqué plus haut, le rôle de certains états a été crucial dans les changements intervenus depuis les années quatre-vingts. Ainsi, la déréglementation financière aux Etats-Unis a été décidée et voulue par l’administration Reagan. Les institutions internationales sont le prolongement des Etats-nations, et principalement du club des grands Etats impérialistes.
De ce point de vue nous sommes effectivement entrés dans une nouvelle phase du déjà long processus historique de l’impérialisme. Ainsi, nous sommes sortis de la période de l’impérialisme bipolaire (USA-URSS), pour entrer dans un impérialisme multipolaire. A côté des vieilles nations, s’affirment des impérialismes régionaux (Russie, Chine, Inde, Pakistan…).
Nous voyons aujourd’hui à l’œuvre les deux tendances contradictoires du capitalisme, mises en évidence par Lénine et Boukharine au début du 20e siècle, que sont la tendance à la concentration du capital à l’échelle nationale, et la tendance à l’internationalisation du capital.
Les « Trente glorieuses » ont vu le développement
considérable du capital à l’intérieur des frontières
nationales, tandis que l’internationalisation se poursuivait à un
rythme lent. Actuellement, cela s’est inversé, nous sommes passés
de la période du capitalisme d’Etat au capitalisme trans-étatique9.
L’une des manifestations de ce capitalisme trans-étatique est la
tendance à la constitution de marchés communs (Alena en Amérique
du Nord, Mercosur en Amérique latine), et donc à l’émergence
de blocs régionaux capitalistes dépassant les frontières
des Etats nations.
Ce processus en cours n’en est qu’à ses débuts,
il donne une configuration instable, en raison de la contradiction entre
les termes « national » et « international », au
système. L’exemple de l’Union européenne est révélateur
de ces difficultés, puisque après soixante ans de «
construction européenne », il y a désormais une monnaie
unique et un embryon d’armée, mais pas de gouvernement central.
Il est important de préciser que pour le capitalisme se pose une autre contradiction, qui se révélera problématique avant que le processus décrit plus haut n’arrive à son terme. Ce problème est assez simple, il s’agit de l’augmentation des coûts pour le système10. La pollution de l’air et de l’eau, de l’environnement en général, va devenir un coût majeur dans le futur, et les entreprises en sont la source. Mais avec l’informatisation et le progrès technologique, c’est l’ensemble des coûts d’entretien, de recherche et d’investissement qui s’envolent, et tous les secteurs de l’économie sont concernés. A terme, cela signifie une nouvelle baisse de la productivité du capital et du taux de profit. Les technologies de l’information n’ont fait que renforcer la tendance du capitalisme à augmenter les dépenses en moyen de production, et donc à réduire au maximum la part des salaires, ce qui à terme peut nuire à la croissance et accélérer la crise de surproduction.
Ce qui apparaît de plus en plus évident, c’est le décalage entre la logique du capitalisme (course aux profits) et les besoins humains. Le slogan du système en ce nouveau siècle semble être : « toujours plus pour le profit, et toujours moins pour le travail ». La contradiction entre la production pour le profit et les besoins sociaux a pu être estompée le temps d’une génération durant la période faste des « Trente glorieuses ». Ce n’est plus le cas. Cela rend d’autant plus impératif la question du renversement du système.
Stéphane Lanchon
source : http://pagesperso-orange.fr/revuesocialisme/s6concurrence.html


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F57%2F494997%2F129641032_o.gif)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F62%2F494997%2F126696163_o.jpg)